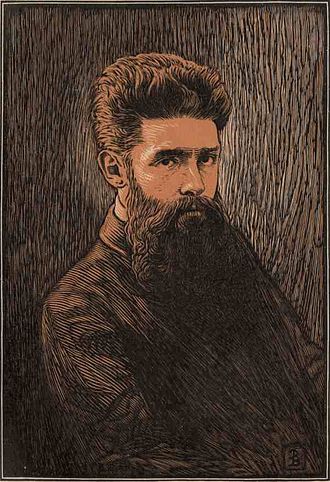À deux absents
Couple heureux et brillant, vous qui m’avez admis
Dès longtemps comme un hôte à vos foyers amis,
Qui m’avez laissé voir, en votre destinée
Triomphante, et d’éclat partout environnée,
Le cours intérieur de vos félicités,
Voici deux jours bientôt que je vous ai quittés ;
Deux jours, que seul, et l’âme en caprices ravie,
Loin de vous dans les bois j’essaie un peu la vie ;
Et déjà sous ces bois et dans mon vert sentier
J’ai senti que mon cœur n’était pas tout entier.
J’ai senti que vers vous il revenait fidèle
Comme au pignon chéri revient une hirondelle,
Comme un esquif au bord qu’il a longtemps gardé ;
Et, timide, en secret, je me suis demandé
Si, durant ces deux jours, tandis qu’à vous je pense,
Vous auriez seulement remarqué mon absence.
Car sans parler du flot qui gronde à tout moment,
Et de votre destin qu’assiège incessamment
La Gloire aux mille voix, comme une mer montante,
Et des concerts tombant de la nue éclatante
Où déjà par le front vous plongez à demi ;
Doux bruits, moins doux pourtant que la voix d’un ami ;
Vous, noble époux ; vous, femme, à la main votre aiguille,
À vos enfants ; chaque soir, en famille,
Vous livrez aux doux riens vos deux cœurs reposés,
Vous vivez l’un dans l’autre et vous vous suffisez.
Et si quelqu’un survient dans votre causerie,
Qui sache la comprendre et dont l’œil vous sourie,
Il écoute, il s’assied, il devise avec vous,
Et les enfants joyeux vont entre ses genoux ;
Et s’il en vient un autre, puis un autre
(Car chacun se fait gloire et bonheur d’être votre),
Comme des voyageurs sous l’antique palmier,
Ils sont les bienvenus ainsi que le premier.
Ils passent ; mais sans eux votre existence est pleine,
Et l’ami le plus cher, absent, vous manque à peine.
Le monde n’est pour vous, radieux et vermeil,
Qu’un atome de plus dans votre beau soleil,
Et l’Océan immense aux vagues apaisées
Qu’une goutte de plus dans vos fraîches rosées ;
Et bien que le cœur sûr d’un ami vaille mieux
Que l’Océan, le monde et les astres des cieux,
Ce cœur d’ami n’est rien devant la plainte amère
D’un nouveau-né souffrant ; et pour vous, père et mère,
Une larme, une toux, le front un peu pâli
D’un enfant adoré, met le reste en oubli.
C’est la loi, c’est le vœu de la sainte Nature ;
En nous donnant le jour : « Va, pauvre créature,
Va, dit-elle, et prends garde au sortir de mes mains
De trébucher d’abord dans les sentiers humains.
Suis ton père et ta mère, attentif et docile ;
Ils te feront longtemps une route facile ;
Enfant, tant qu’ils vivront, tu ne manqueras pas,
Et leur ardent amour veillera sur tes pas,
Puis, quand ces nœuds du sang relâchés avec l’âge
T’auront laissé, jeune homme, au tiers de ton voyage,
Avant qu’ils soient rompus et qu’en ton cœur fermé
S’ensevelisse, un jour, le bonheur d’être aimé,
Hâte-toi de nourrir quelque pure tendresse,
Qui, plus jeune que toi, t’enlace et te caresse ;
À tes nœuds presque usés joins d’autres nœuds plus forts ;
Car que faire ici-bas, quand les parents sont morts,
Que faire de son âme orpheline et voilée,
À moins de la sentir d’autre part consolée,
D’être père, et d’avoir des enfants à son tour
Que d’un amour jaloux on couve nuit et jour ? »
Ainsi veut la Nature, et je l’ai méconnue ;
Et quand la main du Temps sur ma tête est venue,
Je me suis trouvé seul, et j’ai beaucoup gémi,
Et je me suis assis sous l’arbre d’un ami.