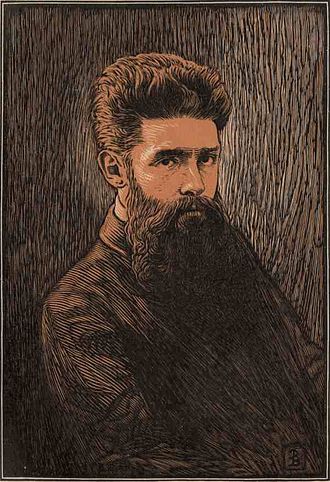La Prophétie de Calchas
Comme les Danaens assemblés devant Troie
Buvaient à ses trésors de festin en festin,
Et, les regards fixés sur cette riche proie,
Vivaient joyeusement dans l’espoir du butin ;
Tous les guerriers, couchés sur le sable par troupes,
Tenaient de gais propos, ou puisant tour à tour
Dans le large cratère et remplissant les coupes,
Entonnaient en riant quelque chanson d’amour.
Les uns, près de la mer pleine de doux murmures,
Livraient leurs yeux songeurs aux caresses des flots,
Et d’autres, au soleil, fourbissaient les armures,
Les casques sans panache et les lourds javelots.
Bientôt, s’écriaient-ils, entends-nous, ville infâme !
Tes héros tomberont sous le glaive mortel,
Et le rouge incendie, avec ses dents de flamme
Mordra tes blanches tours qui montent jusqu’au ciel.
Nous fondrons sur tes murs comme le vent d’orage,
Enivrés au galop des coursiers triomphants,
Et rien n’arrêtera notre jalouse rage,
Ni les femmes en pleurs, ni les jeunes enfants.
La ville de Priam et toute la Phrygie
Sera comme un palais ceint de rideaux vermeils,
Où, pour nous éclairer comme une aube rougie,
Les frontons enflammés serviront de soleils.
Nous tuerons tes grands bœufs pareils à des colosses,
Et tes moutons de neige et tes boucs aux beaux fronts,
Et nous laisserons prendre aux animaux féroces
Le reste des festins que nous dédaignerons.
Les riches vêtements aux laines mariées,
Où la main d’une femme habile à ces travaux
A fait fleurir partout des couleurs variées,
Nous les étalerons sous les pieds des chevaux.
Ta pourpre couvrira l’airain de nos cuirasses,
Et dans tes coupes d’or nous boirons tes doux vins.
Nos bouffons, prodiguant l’insulte et les menaces,
Forceront à chanter les poëtes divins.
Les filles de tes rois et tes jeunes prêtresses,
Se courbant sous le fouet, comme les blancs taureaux,
Les cheveux sur leurs cous échevelés en tresses,
Laveront nos bras nus teints du sang des héros.
Ces vierges sans souillure, à tout amour rebelles,
S’endormiront le soir dans nos bras, les seins nus ;
Les princes et les chefs garderont les plus belles,
Et le reste sera pour les premiers venus.
Alors tu pleureras ton aveugle démence.
Tes rochers et tes mers pousseront des sanglots ;
La Désolation, ainsi qu’une aile immense,
Planera dans la nuit sur tes champs et tes flots.
Tes rois, réfugiés dans les cavernes closes,
Aux sangliers affreux disputeront des glands,
Et les fleuves d’azur, bordés de lauriers-roses,
Rouleront tes débris avec leurs flots sanglants !
Buvant à la fontaine et dormant sous les branches,
Et réservés peut-être à de plus durs exils,
Tes chefs, dont l’or ceignait les chevelures blanches,
Fuiront dans les forêts, couverts de haillons vils !
Et si parfois encor se souvenant du trône
Dans un pays lointain sans palais et sans lois,
Pour obtenir de lui quelque chétive aumône,
Ils disent au passant : Jadis nous étions rois ;
Les enfants aux pieds nus, courant sur le passage
De ces hommes pareils aux spectres des tombeaux,
Leur jetteront alors de la boue au visage
Et viendront déchirer leurs habits par lambeaux.
Tes Dieux même, parmi les champs que tu contemples,
Pleureront, l’œil perdu dans les grands horizons,
Et nous fondrons l’argent des autels et des temples
Pour orner, au retour, le seuil de nos maisons.
Ainsi les Achéens aux flottantes crinières
Ayant des monstres d’or sur leurs larges écus,
Exhalaient sans merci les injures dernières,
Et, d’avance, insultaient aux larmes des vaincus.
Mais cependant Calchas, qui lit dans les pensées,
Leur rappelait ainsi, vieillard chargé d’hivers,
La vénération des Muses délaissées
Et le respect des dieux, maîtres de l’univers :
Achéens, disait-il, votre vengeance ailée
Renverse d’un seul coup les bataillons épars,
Et des Dieux, accourus dans la noire mêlée,
Combattent avec vous sur le devant des chars.
Tels les bruyants troupeaux des jeunes centauresses
Font bouillonner d’horreur les flots des lacs fumants,
Vous traînez après vous les Fureurs vengeresses
Et le cortège affreux des Épouvantements.
Tels, quand l’ardent soleil les couvre de brûlures,
Courbés sur les prés verts, les faucheurs en haillons
Avec l’airain poli tranchent leurs chevelures,
Vos glaives éblouis fauchent les bataillons.
Grâce à votre valeur dans les enfers vantée,
Ce sont partout des morts broyés par des essieux.
La prunelle du jour contemple, épouvantée,
Tout ce sang répandu qui hurle vers les cieux ;
Et de vos ennemis exterminant le reste,
Nourrice de l’Hadès, effroi des nations,
Quand vous êtes passés, la Famine ou la Peste
Vomit derrière vous des imprécations.
Donc, engraissez les champs d’hécatombes humaines !
Soyez comme les loups au milieu d’un bercail !
Que le sang coule à flots dans les gorges des plaines,
Et que vos noirs chevaux en aient jusqu’au poitrail !
Entrez dans Ilios au bruit de la tempête,
Par une nuit d’orage où, pour guider vos rangs,
Les rochers des grands monts rouleront sur sa tête,
Et débordez sur elle avec les noirs torrents !
Qu’on croie entendre aux cieux les astres se dissoudre
En écoutant monter vos clameurs dans les airs !
Que vos cris furieux fassent taire la foudre,
Et que votre incendie éteigne les éclairs !
Sur ces riches palais, ces maisons et ces porches
Où plane un air brûlant et pestilentiel,
Ainsi que des démons qui font voler des torches,
Secouez dans vos mains les colères du ciel !
Soyez comme les loups qui dévorent leur proie !
Déchirez en hurlant ce peuple châtié !
Chargez de durs liens les princesses de Troie,
Et faites des rois même un objet de pitié !
Que rien d’humain ne reste au fond de vos entrailles,
Pas même le respect des morts et des tombeaux !
Que vos seins, réjouis par mille funérailles,
Soient comme un champ de mort où volent des corbeaux !
Que les aigles, quittant leurs rochers et leurs aires,
Volent sinistrement sur tous les alentours !
Déchirez les enfants dans le ventre des mères,
Et préparez leur chair aux petits des vautours !
Guerriers, faites mourir des héros sous les verges,
En les injuriant par des noms abhorrés,
Massacrez les vieillards et meurtrissez les vierges
Sur les corps palpitants des pères massacrés !
Pâles de leur dégoût, rouges de vos morsures
Qu’elles cherchent partout, sous l’éclair de vos yeux,
Des lambeaux de haillons dévorés de souillures
Pour cacher leurs corps, faits à l’image des Dieux !
Et qu’enfin dans leurs flancs sentant l’horreur vivante,
Des aïeules aussi pressent leurs pas tremblants,
Et de leur nudité promenant l’épouvante,
Pour en voiler leurs seins prennent leurs cheveux blancs !
Que dans les noirs bûchers pleins d’horribles murmures,
Flamboyants échafauds qu’un dieu foudroie en vain,
Les guerriers entassés brûlent dans leurs armures,
Ainsi que des parfums dans un vase divin !
Que le vieillard, pareil au cadavre livide,
S’enfuie avec délire, une blessure au flanc,
Et, tendant ses deux mains, cherche sa maison vide
Qui fuit devant ses yeux aveuglés par le sang !
Que tout, jusqu’au tumulte, avec le feu s’éteigne
Dans la sombre fumée, aux aboiements des chiens,
Et que le Simoïs, qui sanglote et qui saigne,
Répète seul le nom de Troie et des Troïens !
Que l’Asie, opulente et superbe naguère
Et dont chaque palais recélait un trésor,
Soit un désert funeste, où vos coursiers de guerre,
Paîtront parmi les champs avec des harnois d’or !
Emplissez de néant ces plaines criminelles !
Mais de meurtres couverts, guerriers victorieux,
Gardez le souvenir des choses éternelles,
Dans vos combats humains n’égorgez pas les Dieux !
Aux souffles des zéphyrs, que la sage Aphrodite
Vénérable aux mortels, sentant ses pleurs taris,
Puisse oublier l’effroi de la guerre maudite,
Et s’égarer pieds nus dans les chemins fleuris !
Que le troupeau charmant des Nymphes et des Grâces,
Qui cherche les flots purs et les abris secrets,
Puisse encore, écartant des mains les feuilles basses,
Mener des chœurs dansants à l’ombre des forêts !
Mais respectez surtout les Muses et les Lyres !
Que les divines sœurs, vierges aux belles voix,
Sur les monts chevelus puissent par leurs sourires
Émouvoir en chantant les rochers et les bois !
Quand les hommes, pareils aux animaux immondes,
Vivaient dans les forêts, c’est la Muse aux beaux yeux
Qui peigna dans ses doigts leurs chevelures blondes
Et leur dit d’élever leurs regards vers les cieux.
Sans elle vous seriez comme des bêtes fauves,
Vous enivrant de meurtre et sans plus de remords
Que la louve affamée et que les vautours chauves
Qui guident leur femelle à l’odeur des corps morts.
Tantôt avec ses sœurs, au soleil des campagnes,
Mêlant la poésie avec les chœurs dansés,
Elle passe, pieds nus, sur le haut des montagnes,
Enchantant l’horizon de ses pas cadencés.
D’autres fois, le sein libre, elles tiennent la lyre
Parmi les Immortels continuant leurs jeux,
On entend résonner de leur hymne en délire
Les radieux sommets de l’Olympe neigeux.
De vos guerres sans fin réparant les désastres,
Elles peuvent, enflant les clairons à grand bruit,
Élever vos exploits jusqu’au-dessus des astres,
Ou les ensevelir dans l’éternelle nuit.
Et, selon votre culte envers les chants lyriques,
Elles vous montreront à l’avenir lointain
Comme des combattants de guerres héroïques,
Ou comme des brigands affamés de butin.
N’offensez pas l’Amour ailé, roi de la terre,
Soit qu’il tienne la foudre ou qu’il tresse des fleurs ;
Car il dompte les loups et la noire panthère,
Et de leurs yeux pensifs il arrache des pleurs.
Et souvent laissant là ses traits, au crépuscule,
Pour braver les grands Dieux dont il a triomphé,
Il entoure ses reins, comme le jeune Hercule,
De la peau d’un lion dans ses bras étouffé.
Ah ! ne dédaignez pas la céleste harmonie !
Malheur à l’insensé qui déchire et qui mord
Le renom de Cypris, mère de tout génie :
Les Dieux lui garderont la folie et la mort !
Ainsi parlait Calchas, et les guerriers farouches
Attachés à sa lèvre avec des liens d’or,
Et tous les chefs laissaient échapper de leurs bouches
Des acclamations pour le fils de Thestor.
Les Ajax, le divin Achille à qui tout cède,
Les Atrides, Mégès accouru sur leurs pas,
S’écriaient tous : Louange à celui qui possède
La science de lire au delà du trépas !
Mais seul, pendant ce temps, Diomède en silence,
Caressant le désir du carnage odieux,
Baissait les yeux à terre, et regardait sa lance
Que devait par deux fois rougir le sang des Dieux.
Mai 1848.